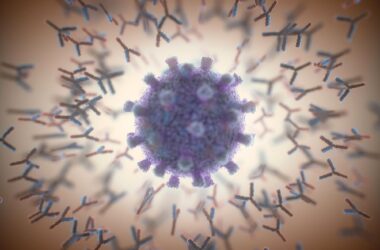Cela signifie quelque chose de mettre un mot sur le sentiment, sur l’expérience. Pouvoir dire : “J’ai ____” ou “Je suis ____” a du poids. Cela ouvre les portes aux traitements, aux médicaments et aux plans.
Mais que faire si ce mot n’est pas le bon, ou même le meilleur ? Il n’y a pas de test sanguin pour la dépression, pas de scanner pour l’anxiété. Notre santé mentale est une chose glissante et souvent subjective à définir.
Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) est depuis longtemps l’étalon-or de la psychiatrie pour définir et identifier nos maladies, un guide qui a contribué à créer un langage et un protocole communs dans ce domaine. Il s’agit également, comme l’écrit l’auteur et activiste Sarah Fay dans son nouveau livre “Pathological : The True Story of Six Misdiagnoses”, d’un outil profondément défectueux.
En commençant par son évaluation de l’anorexie dans son enfance, Sarah Fay a cru ce qu’on lui disait sur elle-même, et ces croyances – ainsi que les thérapies et les médicaments qui les accompagnaient – l’ont profondément affectée. “On m’a dit”, écrit-elle, “avec certitude” quels étaient ses troubles. C’est cette certitude qui mérite une enquête plus approfondie.
Fay est une femme qui connaît le pouvoir d’un traitement efficace de la santé mentale. C’est aussi un écrivain qui a exploré rigoureusement la validité scientifique du DSM, et qui a quelques questions à poser, comme elle l’explique dans son livre et dans notre entretien. En effet, “Pathologique” est à la fois un mémoire intime et un guide utile dans notre système de santé mentale énigmatique.
Juste à temps pour la sortie de la révision du texte du DSM-5, Salon s’est récemment entretenu avec Fay sur le pouvoir et les limites du DSM, et sur ce que nous devons tous comprendre pour prendre en charge notre santé mentale.
Cette conversation a été éditée et condensée pour plus de clarté.
Beaucoup d’entre nous ont récemment passé un test où l’on nous fait un prélèvement nasal, et ensuite nous avons une réponse qui est définitive et décisive. Qu’est-ce qui est différent dans la santé mentale, et qu’est-ce qui est différent spécifiquement dans le DSM ?
Il y a des tests pour les diagnostics physiques. Il y a des exceptions, comme les migraines. Il y a une certaine ambiguïté en médecine physique, mais la plupart de leurs diagnostics sont testables. Nous pouvons avoir une mesure objective de ce à quoi cela ressemble.
“Les diagnostics du DSM, ce sont des listes de symptômes créées par des professionnels de la santé mentale assis autour d’une table. C’est tout ce qu’ils sont. “
Par exemple, nous pouvons voir le cancer sur une radiographie, ou une IRM. L’angine streptococcique a un test pour lequel nous pouvons faire un test positif ou négatif. Il n’y a pas un seul diagnostic DSM qui ait une mesure objective. Je dis cela avec une mise en garde – la démence et certains troubles chromosomiques rares ont des tests biologiques, et plus encore les marqueurs. Mais aucun des autres n’en a, et ce sont ceux-là que nous respectons vraiment.
Ils n’ont pas de réalité objective, ce qui est effrayant à penser. Nous sommes diagnostiqués, et nous acceptons des diagnostics qui n’ont pas cette même réalité objective. [efficacy] qu’un test Covid, où vous recevez un marqueur sur un appareil en plastique qui vous dit oui ou non.
Les erreurs de diagnostic se produisent en médecine physique, et les surdiagnostics et les faux positifs se produisent également. C’est souvent le résultat d’une erreur technologique ou humaine. Mais il existe une sorte de mesure objective que nous pouvons au moins essayer de trouver quel était le diagnostic réel.
Les diagnostics du DSM, ce sont des listes de symptômes créées par des professionnels de la santé mentale assis autour d’une table. Ils sont basés sur des opinions et des théories, pas sur des données concrètes, et sont publiés dans un livre. C’est tout ce qu’ils sont. Le vrai danger est de croire qu’ils sont autre chose que ce qu’ils sont. C’est vraiment pour ça que j’ai écrit ce livre. C’est comme ça que je pensais. Je croyais qu’il s’agissait de diagnostics médicalement valables, scientifiquement prouvés.
Je n’ai jamais vraiment demandé, pourquoi il n’y a pas de test pour ça ? Pourquoi je ne passe pas de test ? La question ne s’est jamais posée. Je n’aurais jamais pensé à demander cela. J’espère que mon livre changera cela, et qu’il amènera les gens à poser plus de questions, à s’interroger davantage, et à aborder ces diagnostics avec un certain scepticisme.
Il y a une phrase que vous utilisez, que c’est un luxe de refuser un diagnostic. C’est une grande partie de cela aussi, avoir cette agence pour repousser et dire, “Attendez une minute, j’ai quelques questions.” Racontez-moi le début de vos six diagnostics, avec le premier.
Quand j’ai écrit le livre, et au moment où je parle du livre, il y a beaucoup de personnes qui sont au premier plan dans mon esprit. Les enfants et les adolescents sont vraiment une partie énorme de tout cela. L’auto-diagnostic sur les médias sociaux est de plus en plus répandu. Le chiffre est de 20 % de tous les adolescents et enfants qui recevront un diagnostic DSM au cours de leur vie. Ce chiffre ne cesse d’augmenter. J’ai reçu mon premier diagnostic d’anorexie à l’âge de 18 ans.J’avais 12 ans. J’avais déjà la lentille du diagnostic posée sur moi.
J’associais déjà la douleur physique, comme un mal de ventre qui vient de l’émotion, et les pensées qui s’emballent, aux diagnostics. J’assimilais déjà la vie et les difficultés au diagnostic. C’est quelque chose que j’espère essayer de prévenir. Je ne savais pas mieux, et beaucoup de parents ne sont pas censés savoir. Ce n’est pas ce que nous disent les professionnels de la santé mentale.
Il n’y a pas eu la transparence que nous voulons vraiment avoir. Ma mère était très désemparée. Je me souviens être allée au Northwestern Memorial Hospital. Mon poids était devenu si bas, et j’étais si mal en point. Lorsque nous sommes entrés dans l’hôpital Northwestern, son visage était si triste et troublé. Elle ne savait pas quoi faire.
C’est la situation dans laquelle je vois beaucoup de parents, d’adolescents et d’enfants en ce moment. Je me demande ce qui se serait passé si nous avions remis en question le diagnostic. L’anorexie est une maladie difficile parce qu’elle est si visible. Elle a des symptômes si concrets. Mais au même moment, mes parents divorçaient. J’allais dans une nouvelle école. Je ne gérais pas mon esprit. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mes pensées étaient toujours en train de s’emballer. Moi, j’étais juste triste, bouleversée, j’avais mal au ventre et je ne voulais pas manger. C’était vraiment un refus de nourriture, parce que je ne me sentais pas bien. Donc je n’ai même pas remis en question ce diagnostic.
Ce livre n’est pas contre les traitements de santé mentale. Il n’est pas contre le fait d’obtenir de l’aide. Il n’est pas contre la réalité des vrais problèmes émotionnels, et des vrais problèmes psychiatriques, et des défis. Alors, de quoi parlez-vous quand vous parlez du diagnostic qui est transmis par les tablettes du DSM, et de ces vrais problèmes auxquels les gens sont confrontés en ce moment ?
Je suis heureux que vous ayez soulevé cette question. Je crois à 100% que la maladie mentale est très, très réelle. Je crois que j’en ai, ou que j’en ai eu une. Je n’ai aucune honte à ce sujet. Je me sens très proche des autres personnes atteintes de maladies mentales graves.
Il y a deux types de maladies mentales. Il y a les maladies mentales graves, et puis n’importe quelle maladie mentale. La maladie mentale grave est définie par le NIMH comme étant une incapacité telle que vous ne pouvez pas vivre de façon indépendante. [Editor’s note: NIMH is an acronym for National Institute of Mental Health, the lead federal agency for research on mental disorders.] Je n’ai pas pu vivre indépendamment pendant cinq ans. Il n’y a aucun doute que quelque chose n’allait pas dès le plus jeune âge.
Je m’identifie tout à fait au fait d’avoir une maladie mentale. La différence réside dans les diagnostics que nous recevons, qui sont inventés. Ce sont des constructions. Ce n’est pas moi qui le dit. C’est Thomas Insel, ancien directeur du NIMH, qui les a appelés “constructions”. Steven Hyman, ancien directeur du NIMH, les appelle des catégories de diagnostics fictifs.
Je n’avais aucune idée que c’était le cas, mais ils sont inventés, et nous essayons d’obtenir de l’aide dans le cadre de ces diagnostics. Il en résulte une pathologisation des émotions, des pensées et des comportements quelque peu normaux. Cela semble problématique à plusieurs niveaux. Pour le grand public, l’idée que 46% des adultes américains recevront un diagnostic DSM au cours de leur vie est une statistique presque absurde à croire.
Il y a de graves maladies mentales, et elles doivent être traitées. Nous devons y consacrer nos ressources. Ensuite, il y a les émotions, les pensées et les comportements normaux, très difficiles et très troublants. Ma question est la suivante, et ce n’est qu’une question : et si nous parlions des symptômes au lieu de diagnostiquer les gens ?
Au lieu d’appeler la dépression le diagnostic, le même terme que l’émotion de la dépression, et si nous parlions de “Vous avez la dépression, ou vous avez la tristesse” ? On pourrait faire ça. Cela répond toujours à un besoin. On ne peut pas, parce que les compagnies d’assurance ne sont pas organisées comme ça.
Pour être très clair, je suis sous traitement. Je n’essaie en aucun cas de remettre en question les diagnostics du DSM au point d’interdire à quiconque de recevoir des services. Je vois un psychiatre, et je le respecte beaucoup. Vous avez mentionné que les diagnostics viennent d’en haut. Le DSM était autrefois appelé la Bible de la psychiatrie, car l’idée était que tout le monde le suive à la lettre.
De nombreux professionnels de la santé mentale se sont défendus en disant : “Eh bien, je ne fais pas vraiment ça.” Ce qui est un peu effrayant, car cela signifie que les diagnostics sont peut-être encore plus aléatoires. Mais maintenant, je pense que l’idée de la Bible du DSM est qu’il s’agit d’un texte intraitable qu’ils ne réviseront pas, et qu’ils ne réformeront pas complètement et ne corrigeront pas les erreurs du passé. Les diagnostics qui y figurent et qui ont conduit à de fausses épidémies, comme le TDAH, l’autisme, etc. La bipolarité en était un gros aussi.
Qu’est-ce que ça veut dire si on n’a pas de diagnostic ? Pouvons-nous apprendre à vivre avec l’ambiguïté de la gestion des symptômes sans nécessairement avoir un nom pour cela ? Et quelle est cette distinction entre, je ressens quelque chose, j’ai quelque chose, je suis quelque chose, j’ai eu quelque chose ? Quelles sont ces distinctions pour vous ?
Je pense que le “avais” est vraiment important.Actuellement, on nous dit, ou du moins on nous fait croire en ne clarifiant pas, que les diagnostics DSM sont chroniques. Ce n’est pas le cas. Il n’y a aucune preuve définitive que c’est le cas. C’est un mauvais service rendu aux gens. “Avait” devrait être là-dedans.
Un de mes amis a consulté un professionnel de la santé mentale qui a mis en place une stratégie de sortie pour lui. Il a dit : “Tu as ça en ce moment. Ce n’est pas chronique. Mettons ça en place quand tu te sentiras mieux.” Pas “si”, mais quand tu te sentiras mieux. C’était une chose qu’il avait, et il pouvait s’en sortir. C’est une grande partie de ça, c’est le “avoir”, “avoir”. On n’en sait pas assez pour l’instant. Comme je l’ai dit, je crois que j’ai une maladie mentale, si c’est comme ça qu’on veut le voir.
Je dois le dire parce que j’ai besoin de médicaments. J’ai besoin d’un traitement. Je dois avoir quelque chose. Je n’ai pas honte. Je veux être un exemple pour les gens. On peut avoir une maladie mentale, même une maladie mentale grave, et ne pas avoir honte. Je l’ai été pendant de très nombreuses années, et je me suis beaucoup caché, et je suis toujours traité. Vous pouvez prendre des médicaments. Il n’y a rien de mal à cela. La communauté du sevrage a parfois honte. C’est ce qu’on appelle la honte de la pilule, et je pense que c’est une direction vraiment terrible pour nous.
Je ne la cite pas exactement, mais Paula Caplan a dit que les étiquettes de diagnostic n’ont jamais réduit la souffrance de quiconque. Je pense que c’est vraiment fascinant. Il y a un vrai risque à mettre un diagnostic sur quelqu’un. À l’heure actuelle, l’Association américaine de psychiatrie et les auteurs du DSM ne font qu’élargir le filet, en essayant de faire diagnostiquer le plus de personnes possible. Le DSM-5-TR sortira en mars.
Ils n’ont pas rectifié les erreurs du passé. Ils ont fait très peu de changements de critères à corriger, et ils ont eu une décennie. C’est la première révision du texte en une décennie. Je pense que c’est là que se trouve le vrai problème. Pourquoi ne prenons-nous pas du recul et ne faisons-nous pas preuve de prudence en acceptant des diagnostics, en les distribuant ou en les donnant ?
Ces diagnostics peuvent vraiment être utilisés contre vous. Il y a un risque réel dans ce diagnostic autant que c’est aussi une chose attrayante à avoir, pour obtenir des services, pour avoir un mot pour ce que vous ressentez que les autres comprennent.
J’ai vraiment traversé cette période, et je me suis demandé si je devais ou non informer les gens de mon département, si je devais informer qui que ce soit que j’écris à ce sujet. Ma famille ne voulait pas que j’écrive ce livre. Ils n’arrêtaient pas de me dire : “N’écris pas ça. Ça va ruiner ta vie.” Maintenant, ils sont très excités par ce livre. Tout s’est bien passé jusqu’à présent. Mais j’ai l’expérience, surtout pour avoir été suicidaire, et ce, à de très nombreuses reprises.
J’ai écrit à ce sujet pour The Rumpus, puis j’ai décidé d’aller sur le marché du travail universitaire. J’ai demandé à mes collègues et à mon patron de l’époque : “Que pensez-vous que je doive faire ? Est-ce que ça va me faire du mal ?” La dépression, l’anxiété, ça va, mais quand on arrive à la schizophrénie et à la suicidalité, eh bien, là, on parle d’autre chose. C’est déjà un problème, que certains diagnostics soient acceptés et d’autres non.
En fait, j’ai fini par enlever mon nom et il est toujours affiché sous le nom de “Sarah F.” C’est dans le livre, donc les gens peuvent le trouver. J’ai tellement de privilèges. Ayant travaillé avec des étudiants handicapés dans les écoles publiques de New York, dans des quartiers économiquement très défavorisés ou marginalisés, ils n’ont aucun des avantages que j’ai eus pour me rétablir et prendre certaines des décisions que j’ai pu prendre. Ou simplement être capable de décider, ok, si ces gens ne veulent pas de moi, alors peut-être que ce n’est pas ma place. C’est un tel luxe d’être capable de le faire.
Quand vous parlez de ce genre d’options, vous vous demandez aussi qui reçoit un diagnostic. Vous parlez de la partialité du diagnostic en termes de trouble défiant, ou de TOC, ou de qui reçoit un diagnostic de schizophrénie. Pourtant, nous pensons toujours que ces diagnostics sont objectifs. Dites-moi pourquoi ils ne le sont pas.
Ils ne sont pas objectifs, parce qu’ils n’ont pas de validité scientifique. Il n’y a pas de marqueur biologique. Il n’y a pas de réalité objective à laquelle les mesurer. L’autre grande chose, c’est qu’ils se fondent les uns dans les autres. Une statistique choquante que j’ai lue dans une étude de Johns Hopkins, c’est que près de la moitié des patients de l’étude qui avaient reçu un diagnostic de schizophrénie ont été réévalués et diagnostiqués comme souffrant soit de dépression, soit d’un autre trouble de l’humeur, soit d’anxiété. Ces diagnostics ne devraient pas avoir ce genre de croisement. Les diagnostics ne sont pas ce qu’on appelle des maladies distinctes. Ils se mélangent tellement, en partie parce qu’ils ne sont pas le résultat de découvertes scientifiques. Ils ne sont pas le résultat de quelqu’un qui voit quelque chose sur un scanner. Elles font l’objet de théories. Comment ne pourraient-elles pas, d’une certaine manière, se mélanger ?
L’autre problème est celui de la fiabilité. C’est quelque chose que je ne savais pas. J’en étais à mon sixième diagnostic quand j’ai lu qu’il fallait toujours voir deux psychiatres. Personne ne m’a jamais dit ça. J’ai juste fait confiance au premier psychiatre que j’aiscie. L’autre problème qui n’est pas soulevé autant qu’il le devrait lorsque nous parlons de santé mentale est que je n’ai pas vu de psychiatre avant d’avoir atteint la quarantaine. J’en ai vu un quand j’avais 12 ans, mais à Northwestern. Mais sinon, mes diagnostics ont été donnés par des médecins de soins primaires. Plusieurs ont été donnés dans des hôpitaux par un homme en blouse blanche avec un stéthoscope autour du cou.
Comment pouvais-je ne pas croire que ces diagnostics étaient scientifiquement valides et fiables ? Que cette personne, qui n’était que des hommes dans mon cas, me donnait vraiment un diagnostic d’en haut, comme vous l’avez dit ?
C’est une question de validité et de fiabilité. Les diagnostics eux-mêmes, toute recherche sur laquelle ils sont basés, sont dans un cadre de recherche, pas dans le monde réel. Nous essayons d’utiliser dans le monde réel des diagnostics qui ont été testés dans un cadre de recherche, et ils ne sont pas transposables, comme s’en plaignent de nombreux professionnels de la santé mentale. Mais nous en avons besoin pour obtenir des services et l’accès aux médicaments, et les professionnels de la santé mentale.
Les médicaments sont une autre chose que nous devons vraiment examiner avec attention. Il s’agit d’une véritable manœuvre du type ” continuez à jeter des trucs contre le mur et voyez où ça colle jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux “. Mais entre-temps, cela peut aggraver votre état. Quand on parle de médicaments, qu’est-ce que les patients ne comprennent pas dans ce qui se passe ?
Je veux juste commencer en disant que beaucoup d’attention est portée sur les grandes entreprises pharmaceutiques qui sont un monolithe diabolique. Je comprends cela, et dans certains cas, c’est bien mérité. En même temps, j’ai beaucoup profité de mes médicaments. Parce que si le diagnostic est solide, les traitements peuvent vraiment aider.
La définition d’une maladie est que vous pouvez dire comment elle est causée, quels sont les symptômes, quel traitement doit être utilisé et le pronostic. Nous n’avons aucun de ces quatre éléments avec la maladie mentale.
Le DSM ne recommande aucun traitement du tout. Nous suivons leurs diagnostics, mais nous n’avons aucun traitement recommandé. Donc, la pharmacie intervient et fait ça. D’une certaine manière, elle a vraiment carte blanche pour le faire.
Il y a deux choses que je dirais. La première est le marché gris – la prescription hors indication. Quand on m’a prescrit un antipsychotique, je me souviens d’être assis dans le bureau de mon psychiatre. Ma sonnette d’alarme s’est mise à sonner. Pourquoi me donne-t-on un antipsychotique alors que je n’ai jamais connu de psychose ? Je ne me suis pas avancé pour demander. Je n’ai pas objecté. Je n’ai pas posé de questions.
On peut prescrire un antipsychotique pour presque tout maintenant. Sachez juste qu’ils prescrivent hors indication. L’autre fait vraiment troublant que j’ai rencontré sont les campagnes de sensibilisation aux maladies. Je ne m’y connais pas assez en marketing, mais j’ai l’impression que c’est quelque chose qu’il faudrait absolument réglementer.
Par exemple, les troubles de l’anxiété sociale sont soudainement partout. Il y a une raison à cela. Ce n’est pas que plus de gens ont un trouble d’anxiété sociale, bien que plus de gens aient une anxiété sociale, évidemment à cause de la pandémie et de la mise en quarantaine. Mais même avant la pandémie, il avait augmenté.
C’est parce que GlaxoSmithKline a obtenu l’approbation pour le Paxil pour traiter le trouble d’anxiété sociale, qui avait un taux de pourcentage d’environ deux pour cent. Puis ils n’ont pas commercialisé le Paxil, ils ont commercialisé les troubles de l’anxiété sociale. Une publicité disait : “Imaginez être allergique aux gens”. Ils ont commercialisé le diagnostic DSM parce qu’ils savaient que cela créerait une augmentation de la demande. Je n’en avais aucune idée.
J’aurais probablement essayé n’importe quel médicament. J’étais désespéré à ce moment-là. Pas au début. J’étais très sceptique. J’étais le genre de personne qui ne prenait pas d’aspirine pour un mal de tête. Je n’aimais pas les pilules. Puis, à la fin, j’ai commencé à prendre et à arrêter des médicaments très rapidement, et je devenais vraiment très malade.
C’est juste quelque chose à garder à l’esprit, poser des questions et dire, “D’où ça vient ? Qu’est-ce que ça veut dire ?” Juste aussi être d’accord et être à l’aise avec l’ambiguïté.
Vous avez parlé de conversation, et c’est ce que je voulais vraiment de ce livre, c’était d’ouvrir une conversation. Je sais que les médecins sont traités d’une certaine manière comme des dieux. Nous avons peur de les remettre en question. C’est normal. Même si nous ne leur posons pas les questions, nous pouvons nous les poser à nous-mêmes. Il faut juste prendre du recul et être un peu plus sceptique.
Plus de reportages de Salon sur la santé mentale :