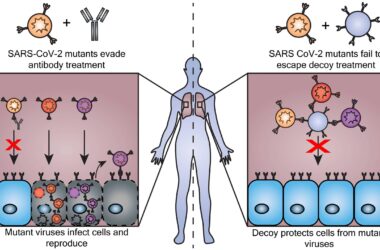À environ trois heures au nord de Las Vegas, dans le Nevada, se trouve la plus grande œuvre d’art contemporain de la planète. La sculpture “City”, qui s’étend sur un kilomètre et demi de long et un demi-mile de large, a été réalisée par l’artiste Michael Heizer. Il s’agit d’un “vaste complexe de monticules et de dépressions formés à partir de terre, de roche et de béton compactés”, selon le site Web de l’œuvre, avec “des allusions à des sites mayas et incas et à des autoroutes interétatiques”, écrit le New York Times. Seuls six visiteurs sont autorisés à entrer dans la “Cité” chaque jour, et les visites pour 2022 sont déjà terminées.
La mégasculpture “City” de Heizer, qui a été inaugurée officiellement la semaine dernière, est connue sous le nom de land art – un mouvement artistique qui a émergé au niveau international dans les années 1960 et 1970 et qui se distingue par le développement de projets de terrassement sculptés à grande échelle, directement sur le paysage. Ces œuvres sont conçues pour exister en dehors des musées et des galeries, et Heizer est l’un des poids lourds de ce mouvement. Son œuvre “Double Negative” de 1969, dans laquelle 240 000 tonnes de roches ont été extraites d’une mesa du Nevada, sur un terrain qui abritait autrefois les Paiute du Sud, pour créer une tranchée, est fondamentale. Mais vous connaissez peut-être mieux la “Spiral Jetty” de Robert Smithson, peut-être l’exemple le plus connu de ce mouvement, qui consiste en une bobine de basalte noir de 1 500 pieds de long, sur la rive nord-est du Grand Lac Salé. L’une des idées du mouvement land art est de créer une valeur pour les paysages de la même manière que l’on valorise l’art dans un musée.
La valeur, bien sûr, est au cœur de la terre aux États-Unis. En général, la valeur (et l’esthétique) des terres en Amérique gravitent autour des notions d’oasis luxuriantes, comme le système des parcs nationaux, les communautés urbaines ou les fermes hautement manucurées. Ces idées trouvent un écho dans l’art américain, et peut-être de la manière la plus agressive (et la plus belle) dans l’imagerie rendue populaire pendant la Grande Dépression par les projets artistiques publics du New Deal qui capturaient la “scène américaine” et projetaient de nouvelles visions du nationalisme.
Il s’agit plus ou moins de fantaisies qui s’appuient sur la peinture patriotique de John Gast “American Progress” – une allégorie de la Destinée Manifeste qui met en scène la figure du “Progrès” dans d’amples robes blanches, couronnée de l’étoile de l’empire, flottant vers l’ouest tandis que les Indiens et les bisons reculent devant sa lumière dans les coins de la toile.
Ces premières visions artistiques du canon américain ont probablement eu un impact sur les artistes terriens en herbe qui ont grandi dans le sillage de l’expansion de l’Ouest et du New Deal. Au milieu du 20e siècle, ces artistes fonciers américains ont commencé à voir la valeur de la terre différemment. Contrairement à leurs grands-parents qui ont répondu à l’appel de la Destinée manifeste et se sont dirigés vers le territoire indien avec cheval et charrue pour racheter et refaire la terre, les artistes terriens ont considéré le terrain comme une toile vide à découper, à dynamiter et à remodeler à leur goût. Au lieu de cultiver la terre pour l’agriculture, les artistes terriens comme Heizer ont physiquement transformé le paysage en quelque chose ayant une valeur culturelle, alchimisant la colonisation en une forme d’art et la rendant monumentale.
À en juger par les photos, “City” est une sculpture étonnamment impressionnante. “Une œuvre architecturale monumentale, aux dimensions comparables à celles du National Mall, à Washington, D.C.”, écrivait le New Yorker en 2016. “Une disposition informée par les villes rituelles précolombiennes comme Teotihuacan”.
Construite sur des terres paiute, saisies à la tribu le 12 février 1874 par décret, “City” bénéficie de terres obtenues sans traité et sans qu’un seul paiement n’ait jamais été effectué par le gouvernement fédéral ou les résidents à ses gardiens indigènes. La Fondation Triple Aught, l’organisation à but non lucratif chargée de superviser “City”, “reconnaît respectueusement que “City” a été créée sur les territoires ancestraux des Nuwu (Paiute du Sud) et des Newe (Shoshoni de l’Ouest)”, mais ne dit rien de plus sur les liens entre l’art, la terre et le peuple auquel il a été volé.
Au lieu de cela, Heizer affirme qu’il a la terre dans le sang et fait référence à l’arrivée de son grand-père au Nevada dans les années 1880 pour exploiter une mine de tungstène comme preuve de son affirmation. Peu importe que la quasi-totalité de l’État ait été confisquée aux tribus sans aucun traité ou accord entre 1863 et 1874, ce qui a permis au grand-père de Heizer de s’y installer en toute sécurité et de vivre de la terre avec le soutien total de l’armée américaine.
Et comme le temps passe vite : Deux générations plus tard, Heizer, dont le travail s’inspire des traditions amérindiennes de construction de tumulus et des villes rituelles précolombiennes d’Amérique centrale et du Sud, a construit “City” au beau milieu d’un territoire indien volé.
J’en suis venu à penser à “City” comme au Mont Rushmore et au barrage Hoover”, écrit Michael Kimmelman, journaliste au New York Times. “C’est une bravade,impressionnant, un testament d’un certain type d’Américain qui peut faire ce qu’il veut.”
Ce qu’il est important de noter à propos du land art, c’est qu’il a une longue histoire. Pensez à Stonehenge, ou au sphinx ; aux géoglyphes de Nazca ou aux tertres d’effigie Ho-Chunk. “Le land art existe depuis que l’homme existe, et les hommes du passé, lorsqu’ils réalisaient des œuvres de land art, c’était pour célébrer la terre sur laquelle ils vivaient ou dont ils étaient originaires, ou pour essayer de s’harmoniser avec cette terre”, explique l’artiste navajo Raven Chacon dans le documentaire de 2017. Through the Repellent Fence : Un film sur le land art.
Le Mont Rushmore, ce testament de l'”America can-do-ism”, offre un autre exemple de cette forme. Taillés dans les Black Hills, sur des terres prises illégalement aux Lakota en 1876 (et reconnues comme telles par la Cour suprême des États-Unis en 1980, et dont les Nations unies ont ordonné la restitution à la nation en 2012), les visages colossaux des présidents américains ont été sculptés sur la face du Tȟuŋkášila Šákpe, les Six Grands-Pères, entre 1927 et 1941 – une montagne d’importance culturelle et religieuse pour les Lakota. Pour le Times, le Mont Rushmore et Ville offrent des exemples fantastiques de land art comme exercice d’ultra-patriotisme, mais pour les autochtones, ces monuments offrent des expériences différentes, plus difficiles.
“Je pense que ce que ces types des années 60, Robert Smithson, Michael Heizer, ont essayé de faire, c’est de détruire la terre”, dit Chacon dans “Through the Repellent Fence”. “C’est mon opinion. C’est donc pour ça qu’ils sont reconnus, parce qu’ils ont juste continué la destruction de la terre et continué à aller coloniser différents endroits qu’ils estimaient être les leurs.”
Parmi les tribus qui ont encore une base terrestre, ces terres, en moyenne, sont plus exposées au changement climatique, notamment à la chaleur extrême et à la diminution des pluies, tandis que les programmes environnementaux ou de rachat de terres gérés par les tribus sont constamment sous-financés. “City”, en revanche, a coûté 40 millions de dollars sur une période de cinq décennies et a nécessité des milliers de tonnes de béton, de roche et d’autres matériaux pour être construit. Que pourraient faire les tribus sur les terres desquelles est construite “City” avec un tel financement ? En 2015, après des années de pétition de la part des magnats du monde de l’art, le président Obama a fait des terres entourant “City” un monument national, protégeant efficacement la zone du développement, de l’exploration pétrolière et gazière et, bien sûr, des Indiens.
“Je ne le compare qu’à lui-même”, a déclaré Michael Govan, directeur du Los Angeles County Museum of Art et membre du conseil d’administration de la Triple Aught Foundation, au Smithsonian Magazine. “C’est une œuvre d’art consciente de nos impulsions primitives pour construire et organiser l’espace, mais elle intègre notre modernité, notre conscience et notre réflexion sur la subjectivité de notre expérience humaine du temps et de l’espace, ainsi que les nombreuses histoires des civilisations que nous avons construites.”
Dans la critique servile de “City” par le Times, Heizer décrit son œuvre achevée comme un “art démocratique, un art pour les âges”, ajoutant : “Je ne suis pas là pour dire aux gens ce que tout cela signifie. Vous pouvez le découvrir par vous-même.” C’est un commentaire pétulant de la part d’un homme qui a passé toute sa vie à construire cette chose, et l’on aurait raison de dire que “City” est un repère pour son propre ego. Mais c’est plus que cela : La clé de “City” de Heizer est de comprendre que l’art, au niveau des 40 millions de dollars, est censé être un statu quo et que les artistes sont des agents – pour les bourgeois, pour les concepts difficiles, pour le patriotisme, pour la révolution – travaillant à conditionner les lieux et les communautés. Dans certains cas, il s’agit d’amorcer le marché de l’art pour le prochain investissement, dans d’autres, il s’agit de soulever des questions et d’ouvrir des idées et des conversations que vous n’aviez jamais envisagées auparavant. En tant qu’agent du mouvement du land art, la création monumentale de Heizer a révélé que le land art est peut-être la forme d’art la plus américaine, entièrement dépendante d’une histoire de violence et de dépossession pour exister.
Mais regardez plus profondément le land artist américain comme un agent de stase : “City” réinscrit les valeurs du colonialisme dans le paysage et régénère les structures de pouvoir visibles et visibles qui ont rendu la création possible. En fin de compte, “City” n’est pas de l’art : C’est un monument au pouvoir de la violence.