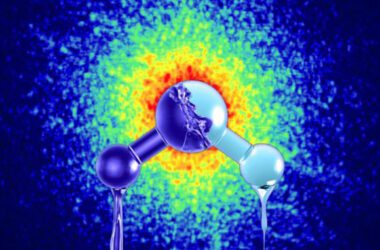Nau début 2 millions de personnes, la plupart d’entre eux, des hommes noirs ou latinos, sont enfermés aux États-Unis. En octobre 2021, le National Institute of Justice, la branche de recherche du ministère américain de la Justice, a publié un rapport affirmant que les agents correctionnels devraient examiner la biologie des personnes emprisonnées – leurs hormones, leur cerveau et peut-être même leurs gènes.
Le rapport décrit un avenir dans lequel les services correctionnels ressemblent un peu plus à la pratique de la médecine qu’à l’imposition de sanctions. Les programmes correctionnels recueilleraient des informations sur les niveaux de cortisol, la fréquence cardiaque, les gènes et la chimie du cerveau des personnes incarcérées, et plus encore. Ils utiliseraient ensuite ces données pour adapter les interventions à des individus spécifiques (par exemple, offrir à une personne une formation à la pleine conscience et un autre médicament pour le TDAH) et pour aider à estimer le risque que quelqu’un récidive.
Pour certains, une telle proposition peut sembler envahissante, voire dystopique. L’auteur du rapport, Danielle Boisvert, criminologue biopsychosociale de la Sam Houston State University, suggère qu’il offre une chance de rationaliser un système maladroit : En « excluant les facteurs biologiques et génétiques connus qui affectent le comportement », écrit-elle dans le rapport, « le système de justice pénale peut être supprimant sa capacité de bénéficier pleinement de ses efforts correctionnels. » (Boisvert n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.)
Le rapport du DOJ représente une nouvelle frontière dans la discipline de la criminologie biosociale – un effort de plusieurs décennies pour ramener la biologie dans l’étude du crime. Des chercheurs dans le domaine ont scanné le cerveau de personnes reconnues coupables de meurtre et fouillé le génome d’adolescents appartenant à des gangs. La criminologie biosociale est “vraiment une sorte de mélange de beaucoup d’autres disciplines, mais en essayant de l’appliquer au comportement humain – et plus particulièrement au comportement antisocial”, a déclaré JC Barnes, criminologue biosocial à l’Université de Cincinnati.
Aujourd’hui, certains des meilleurs programmes de criminologie du pays sont des pôles florissants de la recherche biosociale. Les criminologues biosociaux enseignent aux futurs procureurs, aux forces de l’ordre et aux agents correctionnels.
Mais la montée de la criminologie biosociale a également déclenché l’alarme chez certains chercheurs, qui soutiennent que la science est de mauvaise qualité – et que les idées et hypothèses racistes animent le domaine. “Le travail qu’ils font est vraiment sérieux et vraiment dangereux”, a déclaré Viviane Saleh-Hanna, professeur d’études sur la criminalité et la justice à l’UMass-Dartmouth.
En effet, l’utilisation de la biologie a longtemps divisé les criminologues. Au XIXe et au début du XXe siècle, les criminologues mesuraient les crânes des personnes emprisonnées et analysaient leur structure osseuse. Souvent, ils tiraient des conclusions manifestement racistes. Alors même que la criminologie biosociale devient plus courante, la question reste ouverte de savoir si la discipline peut être démêlée de ce passé raciste. Un examen attentif de la littérature pertinente montre que certains criminologues biosociaux se sont inspirés d’idées discréditées qui décrivent les Noirs comme intrinsèquement prédisposés au crime.
D’autres, tout en évitant d’écrire sur la race, semblent largement tolérer ce travail. “Il ne semble pas y avoir de résistance contre les gens qui écrivent à ce sujet sur le terrain”, a déclaré Oliver Rollins, sociologue médical à l’Université de Washington et auteur de “Conviction : The Making and Unmaking of the Violent Brain “, un livre de 2021 sur les neurosciences et le crime. “Personne ne conteste ce genre de composants racistes à la science ou à la recherche.”
Jdiscutez avec des criminologues de biologie, et un nom revient sans cesse : Cesare Lombroso. Né en 1835 dans le nord de l’Italie, Lombroso a suivi une formation de médecin. Il est rapidement devenu fasciné par la physiologie des personnes condamnées pour des crimes.
Lombroso a disséqué les cadavres de personnes ayant un casier judiciaire, examiné les pieds de travailleuses du sexe et visité des prisons pour mesurer les dimensions de la tête des personnes. Dans son livre de 1876 “Criminal Man”, il a conclu que certaines personnes étaient nées avec une prédisposition à la criminalité – en particulier les personnes qu’il considérait, sans preuve, comme tombant plus bas dans la hiérarchie évolutive, y compris les Italiens du Sud et les personnes d’ascendance africaine. Une collection de spécimens humains, dont 712 crânes, est aujourd’hui conservée au Musée d’anthropologie criminelle Cesare Lombroso à Turin. (Lombroso a également demandé que son propre cadavre, qu’il jugeait supérieur, soit intégré à la collection ; selon le directeur scientifique du musée, Silvano Montaldo, le squelette du criminologue est actuellement exposé, tandis que son cerveau, ainsi que les tissus mous de son visage, sont “conservés dans les entrepôts”, conformément aux “indications de la loi italienne concernant les expositions de restes humains”.)
Le travail de Lombroso a été largement discrédité. Mais son influence, disent les historiens, était considérable – y compris parmi les eugénistes du début du XXe siècle qui cherchaient à identifier et à éliminer les souches de ce qu’ils considéraient comme une dégénérescence des populations. “Les criminologues trouvent édifiant de croire qu’un homme puisse être sauvé par la grâce, mais refusent d’admettre qu’il puisse être damné par le plasma germinatif”, se plaignait l’eugéniste américain Earnest Hooton en 1932, rapportant les résultats d’une étude portant sur 16 000 personnes incarcérées. . Sa conclusion : la biologie comptait. “Je commence à soupçonner que Lombroso, comme Darwin, avait raison”, écrit-il.
À la fin du 20e siècle, cet héritage avait laissé de nombreux criminologues hésitants à s’engager dans la biologie. Pourtant, au milieu des progrès de la génétique et de l’imagerie cérébrale, certains chercheurs ont appelé le domaine à explorer un lien potentiel entre la biologie et la criminalité.
Parmi eux se trouvait Anthony Walsh. Ancien officier de police, Walsh est entré à l’université au milieu de la trentaine, travaillant au noir en tant qu’agent de probation et de libération conditionnelle pour subvenir aux besoins de sa jeune famille. En 1984, il était professeur adjoint de justice pénale à l’Université d’État de Boise, préparant les étudiants à des carrières dans le système de justice pénale. Ses premières recherches portaient principalement sur les lignes directrices en matière de détermination de la peine et le processus de probation.
Au fil du temps, cependant, Walsh est devenu frustré par ses collègues. Il pensait qu’ils passaient trop de temps à se concentrer sur les causes sociales de la criminalité. “Tout et tout le monde était responsable du crime, sauf le gars qui l’a commis”, a-t-il déclaré à Undark dans une interview en 2022. En particulier, Walsh s’est demandé si des domaines comme la génétique et la biologie évolutive pourraient aider à expliquer pourquoi certaines personnes offensent et d’autres non.
Ces types d’enquêtes pourraient faire face à des réactions négatives. Par exemple, en 1992, les National Institutes of Health ont accepté de financer une conférence sur la génétique et la criminalité. L’agence scientifique fédérale a par la suite retiré le financement après un tollé, alimenté par des révélations selon lesquelles un organisateur clé aurait autrefois comparé les quartiers urbains noirs à des jungles. Les critiques craignaient que la génétique ne devienne un outil de haute technologie pour le profilage racial.
Les criminologues comme Walsh n’ont pas fait grand-chose pour dissiper ces craintes. En 1997, lui et un collègue, Lee Ellis, se sont inspirés des théories spéculatives d’un psychologue aligné sur la suprématie blanche pour suggérer que les Blancs avaient évolué pour être moins violents que les Noirs, et que la biologie pourrait expliquer pourquoi plus de Noirs que de Blancs. finir emprisonné.
Pour la plupart des chercheurs sur le crime, ces affirmations posent de sérieux problèmes. Des décennies de recherche – dans de nombreuses disciplines – ont documenté comment des générations de racisme, de privation de droits et de services de police inégaux dirigent de manière disproportionnée les Noirs, les pauvres et d’autres groupes marginalisés vers le système de justice pénale.
Dans le même temps, les experts en évolution humaine disent que la biologie est un outil terrible pour expliquer ce genre de disparités raciales. D’une part, les catégories raciales ne sont que des tentatives grossières de décrire la variation biologique entre les êtres humains, plutôt que des catégories fixes et cohérentes de personnes qui ont évolué le long de trajectoires différentes. D’autre part, même si les scientifiques peuvent parfois identifier des différences génétiques moyennes entre des groupes socialement définis, ces différences ont tendance à être très légères – et n’ont aucun lien évident avec un phénomène social complexe comme un comportement violent.
C’est “juste un peu fascinant que nous présumions qu’il y a quelque chose de si simpliste dans les comportements complexes, qu’il pourrait correspondre à quelque chose comme la couleur de la peau d’une manière assez simple”, a déclaré Deborah Bolnick, experte en évolution humaine et génétique à l’Université du Connecticut.
Malgré ces inquiétudes, Walsh et son co-auteur ont publié leur théorie dans la revue phare du domaine, Criminology. Et Walsh s’est rapidement retrouvé à gagner de nouveaux collègues qui s’intéressaient à la biologie et au crime. À partir de la fin des années 1990, un nombre croissant de criminologues se sont tournés vers la biologie, visant à intégrer la génétique, les neurosciences et la sociologie pour produire des théories plus robustes du crime. Certains craignaient de subir des répercussions professionnelles pour cela. “Mon mentor, quand je lui ai dit ce que je faisais, m’a dit : ‘John, ne fais pas ça'”, a déclaré John Paul Wright, criminologue à l’Université de Cincinnati et l’un des premiers partisans de l’utilisation de la génétique pour étudier le crime. “Il s’inquiétait des conséquences pour ma carrière.”
Wright et d’autres ont appelé la discipline émergente la criminologie biosociale – un changement de marque qui a été achevé en 2009, lorsque Walsh et un collègue ont édité un livre, “Biosocial Criminology”, contenant des essais d’éminents universitaires dans le domaine des jeunes. (Boisvert, l’auteur du rapport du DOJ, a contribué à un chapitre.) Une préface, écrite par un autre criminologue de Cincinnati, Francis T. Cullen, a reconnu l’histoire troublée de la discipline. Les criminologues biosociaux, écrit-il, « devront montrer comment le nouveau paradigme rejette son héritage répressif ».
Ntout le monde n’était pas convaincu que la criminologie biosociale était si différente de ses prédécesseurs.
Saleh-Hanna, professeure à l’UMass-Dartmouth, a commencé à assister à la conférence annuelle de l’American Society of Criminologists dans les années 1990, en tant qu’étudiante. Elle s’est rapidement tournée vers des panels sur la biologie et le crime.
Lors de ces séances, Saleh-Hanna était assise à l’arrière. Elle a pris des notes. Elle parlait rarement. Habituellement, dit-elle, elle était la seule personne noire – en fait, la seule personne de couleur – dans la pièce. “J’ai toujours senti que j’avais la responsabilité envers mes propres communautés d’aller écouter”, a déclaré Saleh-Hanna à Undark. “J’ai toujours su qu’ils parlaient de nous.”
Le processus de base décrit lors de la conférence, a déclaré Saleh-Hanna, ressemblait à un retour à Lombroso : les scientifiques ont examiné le corps de personnes pauvres et marginalisées, isolé certaines caractéristiques biologiques et l’ont utilisé pour suggérer que ces personnes étaient inférieures ou dangereuses. “Ils font toujours le même travail”, a déclaré Saleh-Hanna, “mais ils utilisent ce nouveau langage scientifique.”
Saleh-Hanna a parfois amené un collègue noir, Jason Williams, criminologue à l’Université d’État de Montclair, aux présentations. Il a déclaré que les sessions impliquaient souvent des panels universitaires entièrement blancs commentant la biologie des personnes accusées de crimes. « Ici, vous êtes assis ici dans ce panel, et vous généralisez en grande partie les gens de couleur, mais aussi les Blancs pauvres », a déclaré Williams. “Quiconque est vraiment impuissant, je pense, obtient le bas du bâton avec ces théories, dans ces études.”
En effet, les criminologues biosociaux ont parfois utilisé de nouvelles techniques pour revenir à une vieille conclusion : que la biologie peut aider à expliquer pourquoi le système de justice pénale enferme tant de personnes de couleur. Il y a peu de preuves scientifiques pour étayer cette affirmation. Pourtant, dans le même volume de 2009 dans lequel Cullen exhortait le domaine à rejeter “son héritage répressif”, son collègue de l’Université de Cincinnati, Wright, a écrit un chapitre affirmant que les différences biologiques entre les groupes raciaux expliquent les disparités en matière de criminalité.
Des parties du domaine continueraient à célébrer ces idées : malgré les écrits continus de Walsh sur la race et le crime, la Biosocial Criminology Association lui a décerné son prix pour l’ensemble de ses réalisations en 2014, citant son « impact inestimable sur notre compréhension actuelle des raisons pour lesquelles les gens commettent des crimes et délinquance.”
En 2015, six criminologues, dont plusieurs enseignent dans de grandes universités publiques, ont publié une vaste “théorie unifiée du crime” dans Aggression and Violent Behavior, une revue de criminologie à comité de lecture publiée par l’éditeur scientifique Elsevier. Dans l’article, ils s’inspirent largement des travaux de feu J. Philippe Rushton, professeur de psychologie à l’Université de Western Ontario. Maintenant largement discrédité par la communauté scientifique, Rushton a passé une grande partie de sa carrière à affirmer que les Blancs ont évolué pour être plus intelligents, plus altruistes et moins violents que Les Noirs. Déformant une théorie de l’écologie, Rushton a également soutenu que certains groupes raciaux ont évolué pour être plus fertiles – mais, dans une sorte de compromis, ont également évolué pour être plus agressifs, moins capables d’exercer la maîtrise de soi et moins intelligents.
De nombreux scientifiques décrivent maintenant le travail de Rushton comme incohérent, truffé d’erreurs et ouvertement raciste ; sa propre université l’a finalement désavoué. La théorie est de la “science-fiction de la pulpe” qui est “drapée dans le jargon de la théorie de l’évolution”, a écrit le professeur adjoint d’écologie et de biologie de l’évolution de l’Université de Yale, C. Brandon Ogbunu, dans un essai récent pour Undark.
Bolnick, le chercheur du Connecticut, a déclaré que la théorie de Rushton traite les humains comme des “machines reproductives”, d’une manière qui ne reflète pas vraiment la façon dont les gens vivent. “Cela ne correspond pas au fonctionnement des sociétés humaines ou des familles”, a-t-elle déclaré. Et Rushton et ses acolytes appliquent également la théorie de manière sélective, a-t-elle dit, d’une manière qui ne fait que reconditionner les vieux stéréotypes : par exemple, ils passent peu de temps à considérer les grandes familles de colons blancs aux États-Unis au XIXe siècle.
Pourtant, pendant des années, le travail de Rushton a été cité dans la littérature sur la criminologie biosociale. Dans l’article de 2015, les chercheurs se sont inspirés de Rushton pour spéculer que cette voie évolutive pourrait aider à expliquer les disparités raciales dans les convictions.
Plus tard cette année-là, l’auteur principal de l’article, Brian Boutwell, s’est adressé au magazine de droite Quillette pour se plaindre que les criminologues biosociaux étaient rejetés par leurs collègues. À cette époque, Boutwell et l’un de ses co-auteurs de l’article, le criminologue Kevin Beaver de la Florida State University, sont apparus séparément dans l’émission du podcasteur de droite Stefan Molyneux pour parler des liens entre le crime, la biologie et la race. (Wright, l’un des professeurs de Cincinnati, est également apparu dans l’émission.)
Boudés ou non, les auteurs de l’article ont maintenu des carrières actives. Boutwell est maintenant professeur agrégé à l’Université du Mississippi. L’un de ses co-auteurs, JC Barnes, était jusqu’à récemment président de la division de criminologie biopsychosociale de l’American Society of Criminology. Un autre co-auteur, Beaver, dirige maintenant le Biosocial Criminology Research & Policy Institute de la Florida State University, et il est affilié à la King Abdulaziz University en Arabie saoudite. (Beaver n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.)
De nombreux criminologues biosociaux sont sceptiques quant à de tels travaux sur la race et craignent que cela n’entrave leurs efforts pour faire accepter leurs techniques plus largement, selon Julien Larregue, sociologue à l’Université Laval à Québec qui a étudié le domaine. Mais, a-t-il noté, ces critiques sont pour la plupart informelles : “Si vous regardez les publications, je ne trouve pas beaucoup de refus.”
jen le domaine plus large de la criminologie, cependant, certains experts ont soulevé des questions sur certaines méthodes utilisées par les chercheurs biosociaux. En particulier, certains ont remis en question les efforts visant à tracer une ligne entre des gènes spécifiques et la criminalité ou le comportement antisocial.
L’une des critiques les plus persistantes a été Callie Burt, professeure agrégée à la Georgia State University. Il y a environ 10 ans, on a demandé à Burt de réviser un article examinant la génétique et le crime. Formée en sociologie, elle s’est vite rendu compte qu’elle n’avait pas les outils pour suivre l’argumentation. Sans se laisser décourager, Burt a plongé dans la littérature génétique. “J’ai appris que nous en savons beaucoup plus sur la génétique que je ne le pensais”, a-t-elle déclaré. “Mais plus nous apprenons, plus les choses sont compliquées.”
Burt avait beaucoup à rattraper. Le premier séquençage du génome humain complet, achevé en 2000, s’est accompagné d’une vague de nouvelles recherches visant à lier des gènes spécifiques à des résultats spécifiques. Les criminologues biosociaux ont adopté ce travail. Dans les années 2000, certains se sont tournés vers une méthode alors à la mode appelée étude des gènes candidats, dans laquelle les chercheurs examinent si un gène spécifique peut être lié à certains traits. Certains se sont concentrés sur un lien hypothétique entre le comportement violent et un gène appelé MAOA. (“‘Gangsta Gene’ Identified in US Teens” disait un titre de 2009 d’ABC News, rapportant le travail de Beaver et de ses collègues.) Mais des recherches ultérieures ont jeté le doute sur la plupart des études sur les gènes candidats, y compris celles qui prétendent un lien entre MAOA et la violence. “Cette découverte n’est pas en très bon état”, a déclaré Michael “Doc” Edge, généticien des populations à l’Université de Californie du Sud.
Récemment, certains criminologues biosociaux, dont Boutwell et Barnes, se sont joints à des généticiens comportementaux et à d’autres scientifiques dans le cadre d’études d’association à l’échelle du génome, ou GWAS (prononcé GEE-wahs). La technique, mise au point au cours des deux dernières décennies, analyse de vastes bases de données de données génétiques, à la recherche de corrélations entre des gènes particuliers et certains résultats, tels que la taille, le QI ou l’obtention d’un diplôme universitaire.
Burt et d’autres soutiennent que même ces nouvelles études de grande puissance reposent sur des hypothèses erronées. Comme de nombreux autres experts, elle est sceptique quant à la possibilité de démêler si bien la nature et l’éducation, en partie parce que les catégories de crime et de comportement antisocial sont elles-mêmes si glissantes.
Le problème, selon Burt et d’autres experts, est que le crime et le comportement antisocial ne sont pas des traits simples et faciles à mesurer. Au contraire, ces comportements sont socialement construits et très variables. Quelque chose qui est un crime dans un État – comme fumer de l’herbe – peut être légal dans un autre État. Une action agressive – comme frapper quelqu’un à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il perde connaissance – peut être célébrée dans un contexte (un ring de boxe) et illégale dans un autre (un bar). Et deux personnes peuvent être traitées très différemment pour avoir fait exactement la même chose : la recherche suggère que les enfants noirs du primaire, par exemple, sont plus susceptibles de faire l’objet de mesures disciplinaires que les enfants blancs, indépendamment de leur comportement réel. Et les études révèlent souvent que les adultes noirs qui consomment de la drogue sont plus susceptibles d’être arrêtés et incarcérés que les adultes blancs qui consomment de la drogue.
“Nous nous comportons dans le contexte”, a déclaré Burt. Elle a cité un exemple : les personnes qui ont “des propensions biologiques – et je peux convenir que nous en avons différentes – qui pourraient conduire à l’impulsivité ou à la prise de risques ou même à l’égoïsme et au mépris des autres, une sorte d’activités prédatrices”. Dans un environnement riche, a déclaré Burt, quelqu’un avec ces traits peut finir par s’épanouir : ils vont à Wall Street, où leurs comportements prédateurs entraînent de gros chèques de paie. Pendant ce temps, “quelqu’un qui grandit dans le centre-ville, sans ces opportunités”, a-t-elle ajouté, “peut finir par adopter des comportements prédateurs qui sont criminalisés”.
Burt et d’autres critiques disent que les récits biosociaux de la criminalité ne tiennent tout simplement pas pleinement compte de cette complexité. Une étude reliant, par exemple, des niveaux élevés de testostérone à des crimes risque d’impliquer que les niveaux de testostérone sont immuables – et que les crimes sont en quelque sorte une propriété naturelle définie, comme la taille d’une personne ou la durée d’une journée, plutôt qu’un contingent et cible mouvante.
Saleh-Hanna considère cela comme un problème fondamental sur le terrain, qui remonte à Lombroso. “Il a créé cette impression, avec laquelle nous luttons encore tous les jours dans cette société, cette impression que le crime peut être objectivement défini scientifiquement en dehors de la perception humaine”, a-t-elle déclaré. En conséquence, a-t-elle ajouté, “ces notions de crime et de criminalité continuent d’être considérées comme des éléments naturels des sociétés humaines”.
Certains préjugés, disent les chercheurs, déterminent également les types de crimes qui finissent sous le contrôle des méthodes biologiques – et ceux qui ne le sont pas. “Nous n’avons aucune idée que les crimes de la finance s’expliquent par la biologie”, a déclaré Troy Duster, professeur émérite de sociologie à l’UC Berkeley. “‘Prenons les échantillons d’ADN des personnes impliquées dans le scandale Enron’ – personne n’a suggéré cela.” Ce n’est que lorsque des Noirs, des Bruns et des Blancs pauvres sont impliqués, suggèrent Duster et d’autres chercheurs, que les criminologues commencent à se tourner vers la biologie pour comprendre ce qui a pu mal tourner.
Récemment, certains chercheurs en génétique ont tenté de répondre à certaines de ces préoccupations en élargissant leur cible au “comportement antisocial” – une catégorie fourre-tout qui peut inclure une condamnation pénale, mais aussi des choses comme les résultats des tests de personnalité et le comportement à l’école, bien que ceux-ci aussi viennent avec leurs propres préjugés.
En 2013, Jorim Tielbeek, alors généticien et spécialiste du crime au VU Medical Center Amsterdam, a fondé le Broad Antisocial Behavior Consortium, ou BroadABC, un réseau mondial de chercheurs qui espèrent découvrir certains des gènes associés aux comportements antisociaux. (Le premier article du groupe, publié en 2017, cite brièvement certains des travaux de Boutwell et de ses collègues impliquant Rushton.) Fin octobre, le consortium a publié sa dernière étude, qui s’appuie sur les données génétiques de plus de 85 000 personnes.
Combien ce genre de recherche peut expliquer reste contesté. Malgré toute la puissance de nouveaux outils comme GWAS, certains généticiens disent qu’ils n’ont fait que souligner à quel point la relation entre les gènes et leur environnement est incroyablement complexe.
Selon ces experts, le processus est encore plus difficile lorsqu’il s’agit d’étudier un résultat social complexe comme une condamnation pénale. Eric Turkheimer, un généticien du comportement à l’Université de Virginie connu pour ses prises de position sceptiques, a déclaré à Undark qu’il serait surpris si de telles approches pouvaient représenter ne serait-ce que 1% de la variance parmi quelque chose comme la criminalité, une fois que les chercheurs contrôlent les facteurs de confusion. “Et si c’est vrai,” demanda-t-il, “à quoi ça sert?”
Certains criminologues biosociaux disent que ce genre de préoccupations les a poussés à reconsidérer des éléments de leur travail. Boutwell, professeur à l’Université du Mississippi, a déclaré qu’il avait révisé sa pensée. “Je pense que nos collègues sociologues présentent un argument plus solide lorsqu’ils parlent des facteurs culturels historiques qui ont sous-tendu les disparités que nous constatons”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne soutenait plus ses travaux antérieurs sur la race.
L’un de ses collaborateurs, Barnes, a également décrit un changement d’approche. Barnes a grandi en Caroline du Sud ; son beau-père et ses deux frères et sœurs travaillent dans les forces de l’ordre. En tant qu’étudiant diplômé, il a étudié avec Kevin Beaver à Florida State; un chercheur chevronné dans le domaine l’a décrit, dans un e-mail, comme “probablement le leader le plus éloquent de la jeune génération”. Dans une interview avec Undark, Barnes a déclaré que la lecture des travaux de Turkheimer et de la généticienne comportementale Kathryn Paige Harden l’avait poussé à adopter une approche beaucoup plus prudente pour faire des déclarations sur la génétique et la criminalité. Il a souligné un article plus récent et mesuré sur la génétique et la criminalité qu’il a écrit en 2018. Cet article appelle les chercheurs biosociaux à prêter une attention particulière aux facteurs sociaux et environnementaux, plutôt que de se concentrer sur les gènes isolément. Pourtant, l’article suggère que la génétique pourrait dire quelque chose de significatif sur les raisons pour lesquelles le système de justice pénale incarcère tant de personnes de couleur. “Le temps et le soin que j’ai consacrés à cet article”, a-t-il déclaré, “c’est là que je voulais que les choses se concentrent à partir de là.”
Barnes a déclaré qu’il était devenu plus prudent en tirant des conclusions sur les facteurs complexes qui poussent les gens au crime. “Il est clair que notre constitution génétique et biologique a un impact sur notre comportement”, a déclaré Barnes. “Mais pouvons-nous être beaucoup plus précis que cela? Je ne pense pas que nous puissions le faire à ce stade.”
UNau moins certains les criminologues se sont retrouvés dans une sorte de zone grise – à la fois sceptiques quant à certaines explications biosociales du crime, mais toujours ouverts à l’idée que la biologie joue un certain rôle dans la compréhension de la violence et de la transgression.
Lorsque le criminologue Michael Rocque était à l’université, il a travaillé en étroite collaboration avec feu Nicole Hahn Rafter, une criminologue féministe qui a consacré une grande partie de sa carrière à étudier le sombre héritage de Lombroso, y compris son influence sur le mouvement eugéniste américain. Travailler avec Rafter, a déclaré Rocque dans une récente interview, a eu un effet inattendu : cela l’a poussé à se demander comment la biologie pouvait encore être utilisée de manière responsable pour penser au crime.
Aujourd’hui, Rocque est professeur agrégé au Bates College et il a publié des études documentant comment les préjugés affectent les mesures disciplinaires auxquelles sont confrontés les jeunes étudiants noirs. Il est également co-auteur, avec Barnes et un autre collègue, d’un livre récent sur la criminologie biopsychosociale, et il utilise occasionnellement des méthodes biosociales dans son travail. “J’ai juste lu trop de recherches empiriques et vu trop de preuves que les gènes sont importants”, a-t-il déclaré. “Ils font partie de l’histoire lorsqu’il s’agit de comprendre et d’expliquer un comportement criminel.”
Pourtant, a-t-il averti, les études sur des choses comme la génétique ou les neurosciences dans le crime restent souvent provisoires – et pas prêt pour une utilisation appliquée maintenant. Et si jamais ils sont prêts à être utilisés, a-t-il dit, il faudra mettre en place des protections pour s’assurer que leur utilisation est bénéfique. “À mon avis, nous ne sommes pas au stade où tout cela peut être mis en pratique de manière responsable”, a déclaré Rocque.
Cela n’a pas empêché certains chercheurs d’explorer des applications potentielles. À l’automne 2021, l’Institut national de la justice a organisé un symposium en ligne pour annoncer un nouveau volume sur l’étude des personnes qui renoncent au crime. “Ce volume est une réalisation importante dans le domaine de la recherche sur la justice pénale”, a déclaré Amy Solomon, un haut fonctionnaire du ministère de la Justice nommé par le procureur général Merrick Garland, dans ses remarques liminaires.
Le volume comprenait le rapport de 2021 de Danielle Boisvert, la criminologue de l’État de Sam Houston. (Rocque a également contribué à un chapitre.) Dans une présentation au cours de la session, Boisvert a discuté de certains des nombreux outils qu’un système correctionnel biologiquement informé pourrait utiliser. Parfois, ces outils semblaient brouiller la frontière entre les services correctionnels et les soins médicaux : par exemple, Boisvert a fait valoir que les tests neuropsychologiques et physiologiques pourraient aider à identifier les problèmes de développement chez les personnes incarcérées et leur permettre de recevoir des soins appropriés. De tels tests pourraient potentiellement aider les prisons à mieux évaluer si une personne est susceptible ou non de se retrouver à nouveau incarcérée. Dans certains cas, a-t-elle soutenu, ils peuvent même plaider en faveur du maintien d’une personne hors de prison.
Par la suite, un membre du personnel du DOJ a posé une question à Boisvert : comment ces techniques pourraient-elles éviter de « condamner les gens dès la naissance en fonction de leurs caractéristiques biologiques ? » Boisvert a appelé à des programmes qui se concentrent sur la façon dont l’environnement se manifeste dans le corps – “traumatisme, abus, négligence, consommation de substances, traumatisme crânien, exposition au plomb” – plutôt que sur les gènes des gens.
“Il existe d’autres moyens non invasifs et peu coûteux d’intégrer des facteurs biologiques dans les évaluations”, a-t-elle déclaré, “qui ne reposent pas sur l’ADN”.
De nombreux experts restent sceptiques sur le fait que de telles interventions pourraient jamais faire beaucoup pour réparer un système de justice pénale qu’ils décrivent comme systémiquement raciste et profondément brisé. “Si vous ne faites que rendre ce système plus efficace, alors le racisme continuera d’exister”, a déclaré Rollins, sociologue à l’Université de Washington. Des choses comme les modèles neurobiologiques de la criminalité, a-t-il dit, ne sont pas en mesure de résoudre des problèmes aussi fondamentaux.
“La seule chose qu’ils peuvent vraiment faire”, a-t-il ajouté, “c’est de renforcer ce qui existe déjà”.